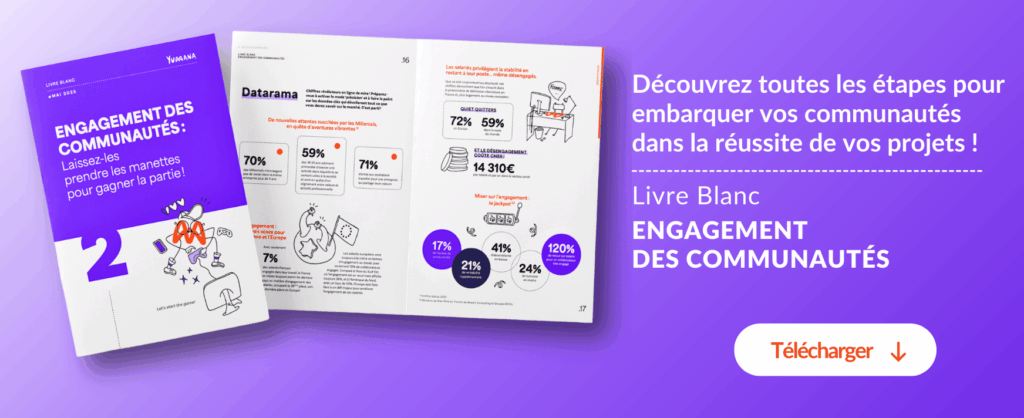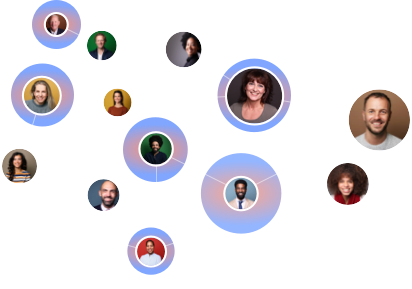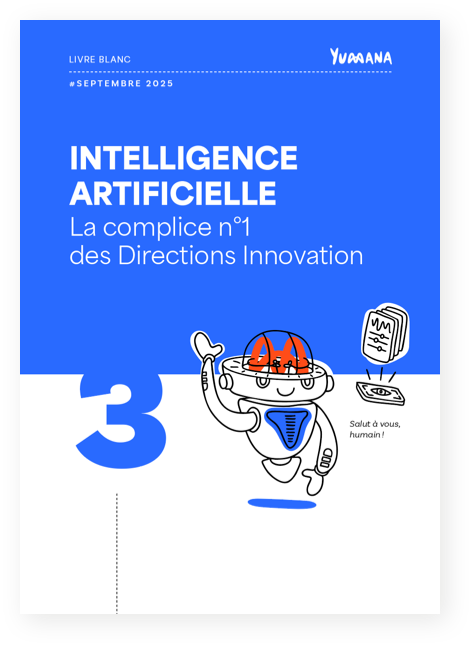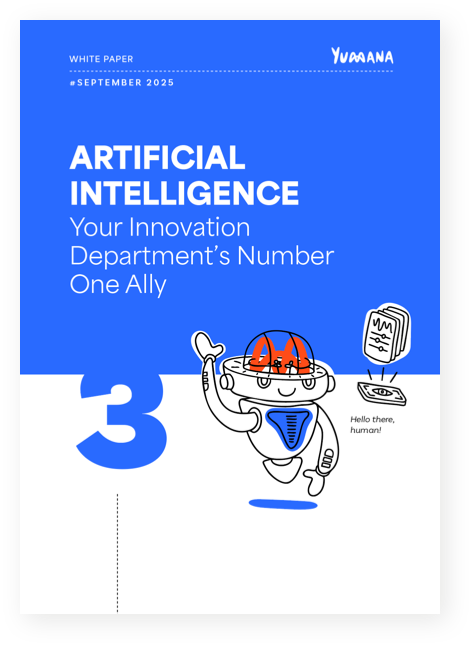Les idées ne manquent jamais. Dans les grandes organisations comme dans les structures plus agiles, elles surgissent, se déposent sur des plateformes collaboratives ou dans des carnets de notes, se partagent au détour d’un café ou d’un comité stratégique. Mais une autre réalité se cache derrière cette abondance : chaque entreprise finit par se heurter aux mêmes questions. Que garder ? Que laisser de côté ? Et surtout, comment décider ?
Cet arbitrage, souvent considéré comme une étape parmi d’autres, est en réalité un point de bascule. Il sépare les initiatives à impact des concepts séduisants, mais irréalistes.
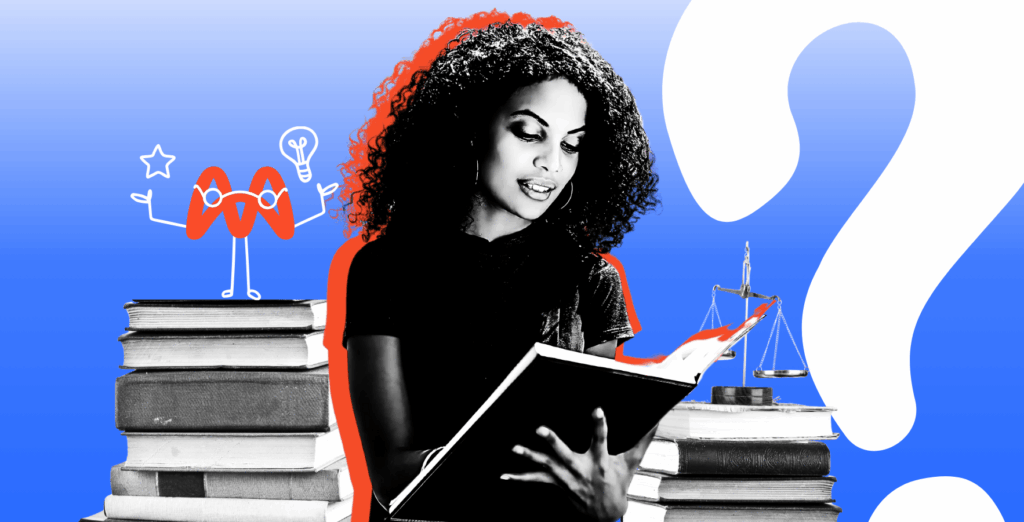
Avant de scorer, qualifier
Toutes les propositions qui remontent d’un dispositif d’innovation ne sont pas des idées. Certaines sont des irritants exprimés, d’autres des suggestions incrémentales, d’autres encore des envies non formalisées.
Pour éviter de gaspiller du temps et de l’énergie, un premier tri s’impose : distinguer les vraies idées des simples constats ou doléances, puis identifier celles qui relèvent réellement de l’innovation.
Qu’est-ce qu’une idée innovante ?
Une idée innovante ne se définit pas seulement par son originalité. Elle doit créer une valeur nouvelle, qu’elle soit économique, sociale ou environnementale, être alignée avec la stratégie de l’organisation et être concrètement réalisable.
Une idée trop en avance ou hors contexte reste un concept séduisant… mais stérile.
Pour aller plus loin : Comment repérer une idée innovante ?
Il peut être utile de positionner l’idée sur un spectre pour adapter la grille d’évaluation.
Posez-vous la question : cette idée est-elle une innovation…
→ …quick win (amélioration simple et rapide) ?
→ …incrémentale (évolution d’un produit ou service existant) ?
→ …adjacente (extension vers un marché proche) ?
→ …disruptive (rupture qui bouleverse un marché) ?
→ ou transformationnelle (création d’un marché ou d’un besoin totalement nouveau) ?
Chaque catégorie nécessite des critères et un niveau d’exigence spécifiques, de la faisabilité immédiate pour les quick wins jusqu’à la vision stratégique et l’intuition pour les innovations créatrices.
L’art d’évaluer : entre rigueur et complexité
Une fois ce premier filtrage opéré, commence l’étape d’évaluation proprement dite. Pour la plupart des entreprises, elle se structure autour de critères rationnels :
→ Pertinence business : l’idée correspond-elle aux activités et objectifs de l’entreprise ?
→ Alignement stratégique : s’inscrit-elle dans la feuille de route à moyen terme ?
→ Maturité technologique : la technologie nécessaire est-elle disponible ?
→ Potentiel marché : quelles sont la taille et l’appétence du marché visé ?
→ Ressources disponibles : l’organisation a-t-elle les compétences et moyens pour la réaliser ?
→ Retour sur investissement attendu : à court, moyen ou long terme ?
→ Risque : financier, opérationnel, réputationnel.
Ces dimensions peuvent être rassemblées dans des scorecards, des grilles d’analyse multicritère, qui facilitent la comparaison des projets de façon homogène. Cela permet de trier rapidement des centaines d’idées et d’orienter les décisions de manière plus objective.
Mais ce n’est pas une science exacte.
Certaines idées cochent toutes les cases et échouent. D’autres, improbables sur le papier, finissent par transformer un secteur.
Les idées qui échappent aux grilles de lecture habituelles
C’est particulièrement vrai pour les innovations dites « créatrices » : ces projets qui ne répondent à aucun besoin exprimé, mais qui font émerger un marché. Le smartphone en est devenu l’exemple archétypal : personne n’imaginait qu’un tel objet, parallèle à l’ordinateur personnel, deviendrait indispensable.
Ces projets ne peuvent pas être évalués uniquement sur des critères de pertinence ou de faisabilité immédiate. Ils nécessitent une autre approche : laisser de la place à l’intuition, à l’expérimentation et à une certaine tolérance à l’incertitude.
→ Lire aussi – Le paradoxe de l’innovation : quand la force des grands groupes devient leur faiblesse
Solliciter l’intelligence collective
Pour enrichir l’évaluation, certaines organisations ouvrent le processus à la communauté.
À travers des votes collaboratifs, elles mesurent la capacité d’une idée à fédérer.
Réfléchir à 3 000 peut parfois produire des intuitions qu’un comité de cinq experts n’aurait pas eues. Cette adhésion interne peut devenir un indicateur précieux, notamment pour des programmes d’intrapreneuriat où la capacité d’un porteur à mobiliser autour de son idée est aussi un gage de réussite.
Cela dit, un équilibre doit être trouvé. Trop de poids donné au vote populaire peut introduire des biais : copinage, effet de mode ou réseaux d’influence internes. À l’inverse, une évaluation exclusivement experte peut passer à côté de signaux faibles perceptibles seulement à grande échelle.
Une évaluation continue
Évaluer n’est pas un moment isolé, mais un processus qui doit accompagner le projet tout au long de sa maturation. À chaque étape (étude de faisabilité, prototype, test marché) les mêmes questions doivent être réévaluées :
- Le marché est-il toujours prêt ?
- Le contexte a-t-il évolué ?
- Le projet reste-t-il aligné avec la stratégie ?
Ce questionnement régulier permet de sécuriser les investissements et d’éviter de poursuivre des initiatives dont le potentiel s’est érodé.
Anticiper pour éviter la saturation
Certaines campagnes d’idéation ont connu un succès si fulgurant qu’il s’est transformé en piège : des centaines d’idées collectées, aucun dispositif d’évaluation prêt à les accueillir, et des équipes innovation débordées face à l’ampleur de la tâche.
Pour éviter cela, un principe s’impose : penser le dispositif d’évaluation dès la conception du programme, pas après. Sans cela, le succès d’un appel à idées peut rapidement se transformer en paralysie organisationnelle.
Évaluer sans brider
Évaluer, c’est arbitrer. Mais c’est aussi savoir laisser une chance à ces idées atypiques qui, aujourd’hui encore fragiles, pourraient demain devenir des leviers de croissance majeurs.
C’est pourquoi, chez Yumana, nous défendons une approche combinée, où rigueur analytique et ouverture à l’imprévu cohabitent. Et cela passe aussi par des outils adaptés.
Sur la plateforme, l’évaluation des idées s’organise ainsi de manière progressive et modulable :
Auto-évaluation du porteur
Dès le dépôt, le contributeur répond à une grille conçue sur mesure.
Cela lui permet d’avoir un premier feedback rapide et d’ajuster son projet en conséquence.
Évaluation par les experts
Des collaborateurs identifiés pour leurs compétences spécifiques apportent leur regard sur
la faisabilité, l’impact ou la pertinence stratégique.
Votes collaboratifs
La communauté peut être invitée à exprimer ses coups de cœur, offrant une lecture complémentaire souvent précieuse pour repérer les idées capables de fédérer.
Scorecards avancées
Des grilles d’évaluation qui synthétisent les critères clés (potentiel marché, ROI attendu, risques, ressources nécessaires) et produisent un scoring pour faciliter les arbitrages.
IA Darwin
Ce copilote du processus, analyse le potentiel d’innovation en croisant plusieurs dimensions : création de valeur, qualité et dynamique des entités impliquées. L’IA détecte les signaux faibles (projets en perte de vitesse, initiatives qui progressent vite ou idées qui mériteraient d’être relancées).
Accompagnement des Yumanistes
Au-delà de la technologie, les experts Yumana aident à structurer le dispositif, à définir les critères d’évaluation les plus pertinents et à ajuster les méthodes en fonction de la culture et des ambitions de l’entreprise.
Cette combinaison de modes d’évaluation permet de gérer des portefeuilles de plusieurs centaines d’idées sans se noyer dans les détails, tout en gardant la capacité de déceler la « pépite » qui ne ressemble à aucune autre.
Autre atout : l’évaluation n’est pas figée. La plateforme permet de réviser les scores au fil des étapes, d’intégrer de nouvelles données, et de requestionner les projets à chaque jalon clé.
Un dispositif qui reflète la réalité de l’innovation : mouvante, itérative, jamais totalement prédictible. Parce que l’innovation ne consiste pas seulement à trier le passé. Elle consiste aussi à accueillir, parfois, l’inattendu.
Conclusion
Faire les bons choix, c’est accepter que l’évaluation ne soit jamais totalement rationnelle.
Un équilibre entre critères objectifs et intuition stratégique est essentiel.
Pour les idées classiques, appuyez-vous sur des grilles d’analyse rigoureuses. Pour les idées créatrices, privilégiez une vision à long terme et la capacité de l’entreprise à porter un pari. Enfin, impliquez vos communautés pour capter des signaux faibles, mais gardez un garde-fou contre les biais d’influence.
Alors, prêt·e à structurer votre démarche d’évaluation ?
N’attendez plus, prenez contact avec nos experts pour échanger sur vos projets et rejoignez la communauté Yumana !

CTO & Co-Founder Yumana